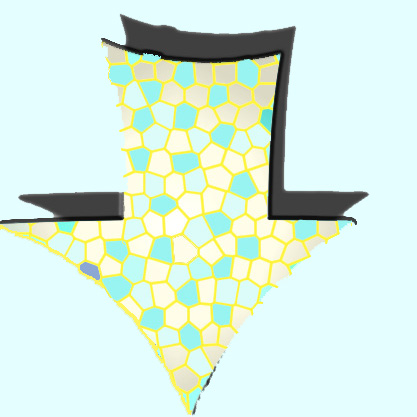Dès 1919, le réseau de salles de
cinéma va progressivement se mettre en place. De ce maillage
d'établissements cinématographiques, trois salles
obscures aux noms évocateurs vont se distinguer et rythmer les
distractions des héninois : Apollo, Caméo et Capitole
vont devenir les pôles de divertissement de toute une population
avide de joie et de gaieté au sortir d'une longue semaine de
labeur.
De 1919 jusqu'à l'arrivée du parlant au début des années trente, Hénin-Liétard possède en ses murs quatre exploitations cinématographiques dites « libres ». Deux salles continuent l'exploitation d'avant guerre : le Cinéma Français de Jules-Ernest Larrivière situé rue Jules Guesde, ancienne rue de Bon-Secours, et l'Alhambra du boulevard Fallières qui prend la suite du cinéma Mellin. Deux sont de création d'immédiat après-guerre : l'Apollo situé place Loubet, futur place Wagon, et le Familia, rue Elie Gruyelle qui va devenir le capitole en 1933.
Placé à l'int ersection du boulevard Fallières et de la rue de
Douai près du coron de la Filature, le cinéma Alhambra
semble poursuivre l'exploitation Mellin d'avant guerre. La salle se
trouve au premier étage d'un immeuble qui comprend des logements
au rez de chaussée et au second étage. Le
propriétaire des locaux est M. Mellin-Decourcelles, mais le
directeur de l'établissement est Humbary Davies,
également gérant de l'Apollo. La salle peut accueillir
468 spectateurs. Mais elle est loin de remplir les conditions
élémentaires de sécurité. En
décembre 1928, le sous-préfet de Béthune
s'inquiète auprès de son supérieur de
l'état de cette salle suite aux demandes du maire Adolphe
Charlon qui ne souhaite pas intervenir personnellement pour des raisons
d'ordre local. Aussi, une commission de sécurité publique
est envoyée visiter l'Alhambra, ainsi que les autres salles
héninoises le 19 janvier 1929. Cette Commission,
présidée par le maire, est composée du commissaire
de police, du capitaine des sapeurs-pompiers et du directeur des
travaux municipaux. Elle juge l'impossibilité d'évacuer
en cas de panique à cause de la petitesse des couloirs
latéraux et de l'insuffisance de la largeur des portes de
sortie. La Commission craint des scènes de piétinement de
la foule en cas d'évacuation dans les escaliers,
l'établissement étant au premier étage. La salle
est alors qualifiée de dangereuse pour les spectateurs. En mai
1929, une Commission des bâtiments civils souhaite diminuer le
nombre de places et modifier les escaliers. La procédure
poursuit son cours et, les travaux n'étant pas effectués,
le maire décide par arrêté de fermer la salle
à partir du 14 avril 1931. Elle ne rouvrira plus.
ersection du boulevard Fallières et de la rue de
Douai près du coron de la Filature, le cinéma Alhambra
semble poursuivre l'exploitation Mellin d'avant guerre. La salle se
trouve au premier étage d'un immeuble qui comprend des logements
au rez de chaussée et au second étage. Le
propriétaire des locaux est M. Mellin-Decourcelles, mais le
directeur de l'établissement est Humbary Davies,
également gérant de l'Apollo. La salle peut accueillir
468 spectateurs. Mais elle est loin de remplir les conditions
élémentaires de sécurité. En
décembre 1928, le sous-préfet de Béthune
s'inquiète auprès de son supérieur de
l'état de cette salle suite aux demandes du maire Adolphe
Charlon qui ne souhaite pas intervenir personnellement pour des raisons
d'ordre local. Aussi, une commission de sécurité publique
est envoyée visiter l'Alhambra, ainsi que les autres salles
héninoises le 19 janvier 1929. Cette Commission,
présidée par le maire, est composée du commissaire
de police, du capitaine des sapeurs-pompiers et du directeur des
travaux municipaux. Elle juge l'impossibilité d'évacuer
en cas de panique à cause de la petitesse des couloirs
latéraux et de l'insuffisance de la largeur des portes de
sortie. La Commission craint des scènes de piétinement de
la foule en cas d'évacuation dans les escaliers,
l'établissement étant au premier étage. La salle
est alors qualifiée de dangereuse pour les spectateurs. En mai
1929, une Commission des bâtiments civils souhaite diminuer le
nombre de places et modifier les escaliers. La procédure
poursuit son cours et, les travaux n'étant pas effectués,
le maire décide par arrêté de fermer la salle
à partir du 14 avril 1931. Elle ne rouvrira plus.
C'est en 1928 que Germain Larivière succède à son père Jules-Ernest à la tête du commerce familial, le Cinéma Français, situé 8 rue Jules Guesde, ainsi que l'estaminet qui le juxtapose. Propriété du brasseur Joseph Gourlet, cet ancien hangar construit vers 1890, devient un cinéma à l'initiative de son locataire Jules-Ernest Larivière en 1906. D'une longueur de 22 mètres sur une largeur de 14, la salle peut recevoir 800 spectateurs issus principalement d'un milieu ouvrier, provenant essentiellement de la Cité de la Perche. Accueilli lors des trois séances régulières par semaine par un personnel de six membres masculins, le public découvre les péripéties de Charlot, Laurel et Hardy, et les actualités Éclair. Né le 27 décembre 1899 à Lens, Germain Larivière aide son père dès l'age de sept ans. Il poursuit quelques études sur le fonctionnement de l'électricité puis maîtrise rapidement la cabine de projection. Il se marie ensuite avec Marguerite Gambier. Suite à la même Commission locale de janvier 1929, le Cinéma Français doit revoir ses installations. La disposition des couloirs est mauvaise et, en cas d'incendie, le public serait rapidement asphyxié. La Commission exige la construction d'un nouvel escalier puis le dégagement du balcon, l'élargissement des portes de sortie, la diminution du nombre de sièges et le remplacement des bancs par des fauteuils à bascule fixés au plancher. En juin 1932, la municipalité menace de sanctionner le Cinéma Français. Larivière fait les transformations nécessaires au cours de l'été 1932. Les bancs laissent la place à des sièges en bois à « claquettes » et des escaliers sont aménagés. Germain Larivière poursuit ses investissements : il change de projecteur et adopte le parlant. Il sauve son cinéma.
Bâti sur la place Loubet, futur place Wagon, l'Apollo apparaît dès 1919. Dirigé par un écossais Humbary Davies, également gérant de l'Alhambra, la salle ressemble à un baraquement entièrement en planches avec un revêtement extérieur en tôles usagées. Avec 936 places, c'est le plus vaste cinéma de la ville. Davies devance la Commission de sécurité en achetant à la ville le 25 septembre 1928 le terrain de ce qui va devenir le cinéma Apollo,
connu jusqu'à l'incendie de 1985. La déclaration des
travaux de construction d'une salle de cinéma est faite à
la mairie le 20 avril 1929. Le 23 octobre de la même
année, le nouvel Apollo est inauguré. Plus vaste avec
1100 personnes assis sur des sièges en rembourrages et accueilli
par un personnel de quatorze employés. La salle se dote des
dernières innovations techniques et le projecteur utilisé
est de marque Western Electric. L'ancien cinéma en tôles
ondulées est transformé en salle de danse et le
succès est complet, vidant les autres salles existantes : le
Palais de fleurs, le Dancing Palace... L'Apollo devient alors un haut
lieu de la société héninoise : après
l'émerveillement à la vision des drames, des
comédies et des actualités du Pathé-Journal, le
public peut s'enivrer dans la danse et la musique. En 1933, la
publicité de l'Apollo est une chanson publiée dans
l'Hebdomadaire d'Hénin-Carvin le 28 mai 1933 :
terrain de ce qui va devenir le cinéma Apollo,
connu jusqu'à l'incendie de 1985. La déclaration des
travaux de construction d'une salle de cinéma est faite à
la mairie le 20 avril 1929. Le 23 octobre de la même
année, le nouvel Apollo est inauguré. Plus vaste avec
1100 personnes assis sur des sièges en rembourrages et accueilli
par un personnel de quatorze employés. La salle se dote des
dernières innovations techniques et le projecteur utilisé
est de marque Western Electric. L'ancien cinéma en tôles
ondulées est transformé en salle de danse et le
succès est complet, vidant les autres salles existantes : le
Palais de fleurs, le Dancing Palace... L'Apollo devient alors un haut
lieu de la société héninoise : après
l'émerveillement à la vision des drames, des
comédies et des actualités du Pathé-Journal, le
public peut s'enivrer dans la danse et la musique. En 1933, la
publicité de l'Apollo est une chanson publiée dans
l'Hebdomadaire d'Hénin-Carvin le 28 mai 1933 :
De 1919 jusqu'à l'arrivée du parlant au début des années trente, Hénin-Liétard possède en ses murs quatre exploitations cinématographiques dites « libres ». Deux salles continuent l'exploitation d'avant guerre : le Cinéma Français de Jules-Ernest Larrivière situé rue Jules Guesde, ancienne rue de Bon-Secours, et l'Alhambra du boulevard Fallières qui prend la suite du cinéma Mellin. Deux sont de création d'immédiat après-guerre : l'Apollo situé place Loubet, futur place Wagon, et le Familia, rue Elie Gruyelle qui va devenir le capitole en 1933.
Placé à l'int
 ersection du boulevard Fallières et de la rue de
Douai près du coron de la Filature, le cinéma Alhambra
semble poursuivre l'exploitation Mellin d'avant guerre. La salle se
trouve au premier étage d'un immeuble qui comprend des logements
au rez de chaussée et au second étage. Le
propriétaire des locaux est M. Mellin-Decourcelles, mais le
directeur de l'établissement est Humbary Davies,
également gérant de l'Apollo. La salle peut accueillir
468 spectateurs. Mais elle est loin de remplir les conditions
élémentaires de sécurité. En
décembre 1928, le sous-préfet de Béthune
s'inquiète auprès de son supérieur de
l'état de cette salle suite aux demandes du maire Adolphe
Charlon qui ne souhaite pas intervenir personnellement pour des raisons
d'ordre local. Aussi, une commission de sécurité publique
est envoyée visiter l'Alhambra, ainsi que les autres salles
héninoises le 19 janvier 1929. Cette Commission,
présidée par le maire, est composée du commissaire
de police, du capitaine des sapeurs-pompiers et du directeur des
travaux municipaux. Elle juge l'impossibilité d'évacuer
en cas de panique à cause de la petitesse des couloirs
latéraux et de l'insuffisance de la largeur des portes de
sortie. La Commission craint des scènes de piétinement de
la foule en cas d'évacuation dans les escaliers,
l'établissement étant au premier étage. La salle
est alors qualifiée de dangereuse pour les spectateurs. En mai
1929, une Commission des bâtiments civils souhaite diminuer le
nombre de places et modifier les escaliers. La procédure
poursuit son cours et, les travaux n'étant pas effectués,
le maire décide par arrêté de fermer la salle
à partir du 14 avril 1931. Elle ne rouvrira plus.
ersection du boulevard Fallières et de la rue de
Douai près du coron de la Filature, le cinéma Alhambra
semble poursuivre l'exploitation Mellin d'avant guerre. La salle se
trouve au premier étage d'un immeuble qui comprend des logements
au rez de chaussée et au second étage. Le
propriétaire des locaux est M. Mellin-Decourcelles, mais le
directeur de l'établissement est Humbary Davies,
également gérant de l'Apollo. La salle peut accueillir
468 spectateurs. Mais elle est loin de remplir les conditions
élémentaires de sécurité. En
décembre 1928, le sous-préfet de Béthune
s'inquiète auprès de son supérieur de
l'état de cette salle suite aux demandes du maire Adolphe
Charlon qui ne souhaite pas intervenir personnellement pour des raisons
d'ordre local. Aussi, une commission de sécurité publique
est envoyée visiter l'Alhambra, ainsi que les autres salles
héninoises le 19 janvier 1929. Cette Commission,
présidée par le maire, est composée du commissaire
de police, du capitaine des sapeurs-pompiers et du directeur des
travaux municipaux. Elle juge l'impossibilité d'évacuer
en cas de panique à cause de la petitesse des couloirs
latéraux et de l'insuffisance de la largeur des portes de
sortie. La Commission craint des scènes de piétinement de
la foule en cas d'évacuation dans les escaliers,
l'établissement étant au premier étage. La salle
est alors qualifiée de dangereuse pour les spectateurs. En mai
1929, une Commission des bâtiments civils souhaite diminuer le
nombre de places et modifier les escaliers. La procédure
poursuit son cours et, les travaux n'étant pas effectués,
le maire décide par arrêté de fermer la salle
à partir du 14 avril 1931. Elle ne rouvrira plus.C'est en 1928 que Germain Larivière succède à son père Jules-Ernest à la tête du commerce familial, le Cinéma Français, situé 8 rue Jules Guesde, ainsi que l'estaminet qui le juxtapose. Propriété du brasseur Joseph Gourlet, cet ancien hangar construit vers 1890, devient un cinéma à l'initiative de son locataire Jules-Ernest Larivière en 1906. D'une longueur de 22 mètres sur une largeur de 14, la salle peut recevoir 800 spectateurs issus principalement d'un milieu ouvrier, provenant essentiellement de la Cité de la Perche. Accueilli lors des trois séances régulières par semaine par un personnel de six membres masculins, le public découvre les péripéties de Charlot, Laurel et Hardy, et les actualités Éclair. Né le 27 décembre 1899 à Lens, Germain Larivière aide son père dès l'age de sept ans. Il poursuit quelques études sur le fonctionnement de l'électricité puis maîtrise rapidement la cabine de projection. Il se marie ensuite avec Marguerite Gambier. Suite à la même Commission locale de janvier 1929, le Cinéma Français doit revoir ses installations. La disposition des couloirs est mauvaise et, en cas d'incendie, le public serait rapidement asphyxié. La Commission exige la construction d'un nouvel escalier puis le dégagement du balcon, l'élargissement des portes de sortie, la diminution du nombre de sièges et le remplacement des bancs par des fauteuils à bascule fixés au plancher. En juin 1932, la municipalité menace de sanctionner le Cinéma Français. Larivière fait les transformations nécessaires au cours de l'été 1932. Les bancs laissent la place à des sièges en bois à « claquettes » et des escaliers sont aménagés. Germain Larivière poursuit ses investissements : il change de projecteur et adopte le parlant. Il sauve son cinéma.
Bâti sur la place Loubet, futur place Wagon, l'Apollo apparaît dès 1919. Dirigé par un écossais Humbary Davies, également gérant de l'Alhambra, la salle ressemble à un baraquement entièrement en planches avec un revêtement extérieur en tôles usagées. Avec 936 places, c'est le plus vaste cinéma de la ville. Davies devance la Commission de sécurité en achetant à la ville le 25 septembre 1928 le
« Pour être heureux :
Pour être heureux chaq'semaine
Il faut v'nir à l'Apollo
Fredonner toute la s'maine
Tous les airs les plus nouveaux
Au cinéma, c'est une veine!
Car les films sont les plus beaux
Pour être heureux chaq'semaine
Il faut v'nir à l'Apollo ».
A la fin des années 1920, un nouveau
cinéma apparaît. Initialement conçu pour servir de
salle de bal, le Familia, futur Capitole, avait été
construit à l'initiative de M.Lompres au début du
siècle. Après avoir été transformée
un moment en salle de patinage, M.Tonnoir décide d'en faire un
cinéma : le Familia. En 1933, cette salle change de nom et de
gérant : M. Léon Cochon résidant à
Tourcoing et propriétaire du Rex également à
Tourcoing, fait du Familia le Capitole lors de la ducasse de septembre.
Il souhaite offrir aux spectateurs un confort maximum en proposant 960
places aux sièges rembourrés avec un personnel de cinq
employés.
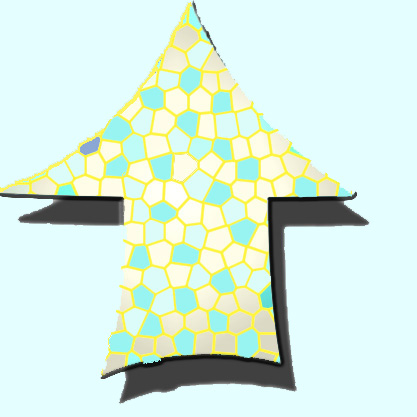 I
I